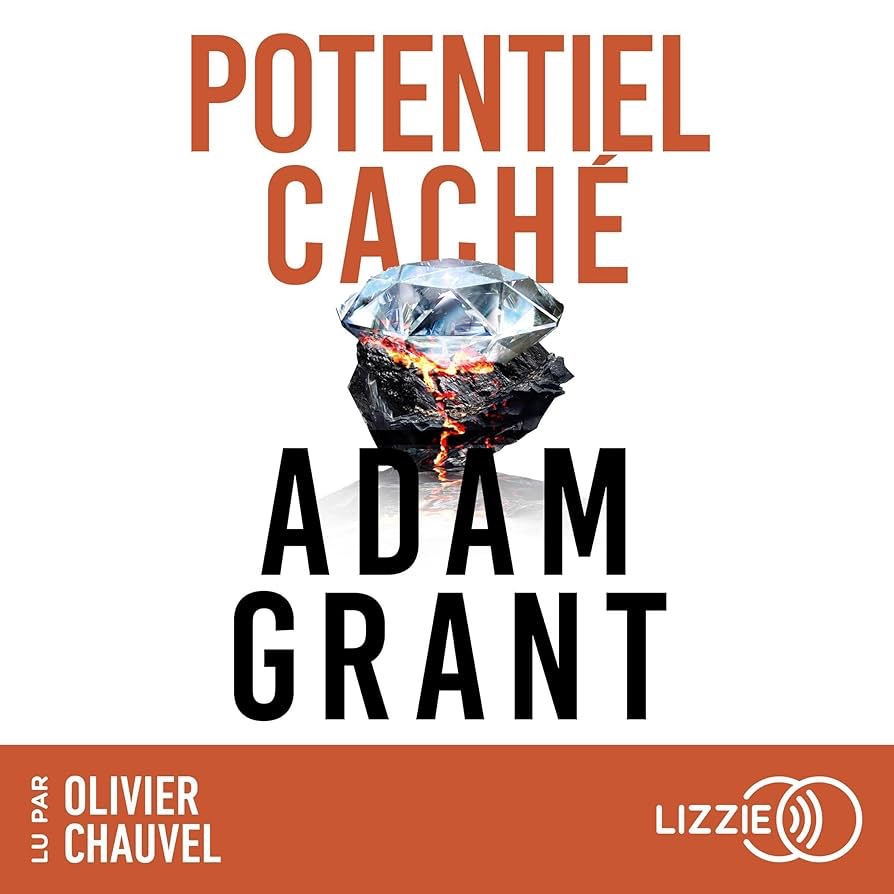Révéler le potentiel caché
Au-delà des résultats scolaires : ce que “Potentiel caché”, par l’auteur Adam Grant, m’a appris sur le rôle du caractère dans la réussite des élèves
Et si la réussite en classe ne dépendait pas uniquement de la personnalité ni des performances, mais aussi, et surtout, du caractère ?
À la lecture de Potentiel caché d’Adam Grant, plusieurs idées m’ont particulièrement marquée : la croissance prend racine dans l’inconfort, les meilleures équipes reposent sur la collaboration, et un accompagnement pédagogique bien conçu transforme durablement les capacités. Ces enseignements m’ont incitée à repenser non seulement la manière dont les élèves apprennent, mais également la façon dont nous, enseignants et éducateurs, pouvons les soutenir dans leur cheminement.
Daniel Pink rappelle, dans ce podcast, que l’apprentissage véritable exige une implication active. Pour ma part, une pratique qui m’a aidée consiste à résumer, à la fin de chaque chapitre, « l’idée principale » en une ou deux phrases. Cela m’a permis non seulement de mieux intégrer les concepts de Grant, mais aussi de les traduire en actions pédagogiques. Voici donc mes principaux constats, que je crois utiles pour les enseignants et les coachs.
Le caractère, et non le confort, comme moteur de la réussite
En lisant Grant, j’ai pris conscience que nous jugeons souvent les élèves par leur point de départ : notes, premières performances ou traits de personnalité. Or, son propos m’a convaincue que le potentiel ne réside pas dans le niveau initial, mais dans la progression possible. Ce qui fait la différence, ce n’est pas la personnalité, par exemple, l’introversion, l’optimisme, ou le perfectionnisme, mais le caractère : la capacité à agir conformément à ses valeurs, malgré ses tendances naturelles, et même lorsque cela est difficile.
Pour les enseignants : ma lecture m’a renforcée dans l’idée que la croissance apparaît lorsque les élèves sortent de leur zone de confort. Un élève timide qui prend la parole ou un élève procrastinateur qui surmonte son hésitation témoignent d’une victoire du caractère. Notre rôle est de créer des conditions où le courage, la persévérance et la maîtrise de soi peuvent se développer, particulièrement dans les moments exigeants.
Le coaching développe les capacités, pas seulement la confiance
Grant m’a amenée à réévaluer l’idée de simplement « féliciter l’effort ». J’ai retenu que le véritable coaching s’apparente à un échafaudage pédagogique : apporter un soutien ciblé au départ, puis se retirer progressivement pour favoriser l’autonomie.
Autre prise de conscience : le type de guidage compte tout autant que son intensité. J’ai retenu que le feedback regarde vers le passé, tandis que le conseil ouvre sur l’avenir. Dire « C’était bien » ne permet pas d’avancer ; demander « Que pourrais-tu améliorer la prochaine fois ? » crée une perspective de progrès.
Pour les enseignants : ma lecture m’a convaincue qu’il est plus efficace de remplacer les encouragements vagues par des conseils concrets et prospectifs. Les élèves ont besoin, au-delà de la confiance, de stratégies pratiques pour avancer.
Faire de l’inconfort un allié pédagogique
Un autre point marquant de ma lecture : l’inconfort et la difficulté ne sont pas des signes d’échec, mais des indicateurs d’apprentissage en cours.
Grant m’a aidée à voir la procrastination non comme de la paresse, mais comme une réponse émotionnelle : éviter des sentiments désagréables comme la frustration ou l’insécurité. J’en ai conclu qu’accompagner les élèves à reconnaître et à affronter ces émotions contribue directement à développer leur résilience.
Pour les enseignants : j’ai retenu l’importance de normaliser l’inconfort. Dire aux élèves : « Si cela semble difficile, c’est que tu apprends », c’est leur rappeler que la préparation vient par l’action, et non avant elle.
Dépasser les « styles d’apprentissage » pour se concentrer sur la tâche
J’ai trouvé particulièrement intéressant que Grant remette en cause l’idée de styles d’apprentissage fixes. Ses arguments m’ont convaincue que, si les préférences existent, elles ne déterminent pas où se produit le véritable apprentissage. Bien souvent, c’est en étant poussés hors de leur zone de confort que les élèves progressent le plus.
- Lire et écrire stimulent la pensée critique.
- Écouter développe l’empathie et la compréhension émotionnelle.
- La pratique concrète renforce la mémorisation.
Pour les enseignants : ma lecture m’a conduite à privilégier la question « Qu’exige cette tâche ? » plutôt que « Quel est ton style d’apprentissage ? ». Encourager les élèves à explorer plusieurs modalités est une piste précieuse : la croissance survient souvent dans la méthode la moins confortable.
Les compétences prosociales, moteur des équipes efficaces
Un autre apprentissage essentiel concerne le travail en équipe. J’ai retenu que les meilleures équipes ne sont pas composées des élèves les plus performants individuellement, mais de ceux qui savent coopérer et valoriser les contributions de chacun.
Grant m’a aussi alertée sur « l’effet de bavardage » : confondre la voix la plus forte avec la plus pertinente. J’ai compris que les équipes prospèrent lorsqu’elles favorisent une écoute active et une inclusion réciproque.
Pour les enseignants : j’ai retenu l’importance de choisir des élèves “leaders” qui incluent et qui écoutent. Un travail d’équipe authentique est celui où chaque voix est entendue et chaque rôle valorisé.
Enseigner pour développer le caractère
À travers ce livre, j’ai compris que le caractère n’apparaît ni dans les notes ni dans les bulletins, mais qu’il est au cœur de l’apprentissage durable. La discipline, la détermination, la résilience, la ténacité et la capacité à affronter l’inconfort ne sont pas des traits figés : ce sont des compétences que l’on peut aider les élèves à développer.
J’ai retenu l’importance de l’échafaudage : guider au départ, puis retirer progressivement les soutiens pour favoriser l’autonomie. Concernant le travail collectif, l’idée de brainwriting m’a semblé particulièrement utile : chaque élève génère d’abord ses idées individuellement, les partage anonymement, puis le groupe les évalue collectivement. Ce procédé équilibre créativité individuelle et collaboration.
Pour les enseignants : ma lecture me confirme que « former au caractère » signifie concevoir des environnements où les élèves n’apprennent pas seulement des contenus académiques, mais développent aussi des qualités comme la persévérance, le courage et la coopération.
Pour une éducation orientée vers l’impact
Enfin, j’ai retenu que les systèmes éducatifs mesurent trop souvent la performance immédiate tel que les notes et classements, au détriment du potentiel futur. Ce que j’emporte de Potentiel caché, c’est que ce qui transforme une trajectoire de vie, ce n’est pas l’information accumulée, mais le caractère forgé : persévérance, humilité, courage et capacité à accepter l’inconfort.
Stratégies pratiques pour la classe
- Remplacer les retours vagues tel que « bon travail » par des conseils tournés vers l’avenir, tel que « la prochaine fois, ajoute un exemple ».
- Échafauder au départ, puis retirer progressivement les soutiens pour construire l’autonomie.
- Reconsidérer la procrastination comme un évitement émotionnel et accompagner les élèves dans la gestion de ces émotions.
- Normaliser l’inconfort : « C’est difficile » peut signifier « c’est efficace ».
- Adapter la méthode à la tâche : écrire pour analyser, écouter pour comprendre, pratiquer pour mémoriser.
- Structurer le travail collectif autour d’objectifs communs et de rôles distincts.
- Utiliser le brainwriting plutôt que le brainstorming afin que chaque élève puisse contribuer.
Contributrice : Marcia Banks